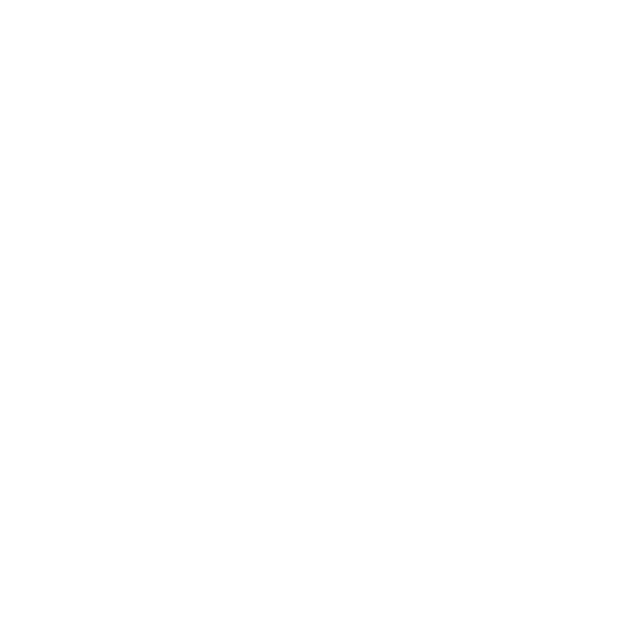Afrotank Magazine: Comment vous définissez-vous ? Dramaturge, metteur en scène, opérateur culturel, gestionnaire de projets culturels ?
Sedjro Giovanni Houansou : Je m’appelle Sèdjro Giovanni Houansou. Je suis né en République du Bénin. Je suis Béninois. J’ai toujours vécu au Bénin. Comment est-ce que je me définirai ? Dramaturge, metteur en scène, opérateur culturel, gestionnaire de projets culturels. Oui, je me définis comme cela (Rires). Mais tout cela, c’est des catégories. Ce sont des cases que la société invente pour vous classer afin de vous distinguer des autres, ou de vous retrouver parmi les autres. Autrement, je pense que pour me définir, je devrais partir de l’intérieur. C’est la meilleure façon de se définir. Donc définissons-nous de l’intérieur, je suis un être humain qui se bat pour ne pas perdre sa part d’humanité. Voilà ce que je suis.
Vous avez une maîtrise en Sciences politique, poursuivie votre formation universitaire par un master Gouvernance et Démocratie de la Chaire Unesco des Droits de l’homme et de la démocratie à l’Université Calavi. Pourquoi s’engager dans un parcours artistique après des études de sciences politiques ?
J’étais déjà dans le parcours artistique avant même d’aller faire des études de sciences politiques. Pour moi, l’un n’efface pas l’autre ou l’un n’empêche pas l’autre d’exister. Je suis juste un peu multitâches. Je ne pourrai pas forcément motiver mes choix entre études de sciences politiques et carrière artistique. Je suis contre le cloisonnement, la sectorisation de la vie. Je pense qu’être un homme politique par exemple puisque moi j’ai été formé pour être politologue donc analyste politique et je vais même au-delà en disant qu’être un homme politique par exemple n’empêche aucunement un homme d’être un artiste ou d’avoir une carrière artistique parallèlement. Donc moi quand j’écris je peux dire que je tire mes ressources de tout ce que j’ai vécu. Mes formations, mes rencontres, mes expériences, mes échecs, tout ça vient prendre corps dans l’écriture. Je ne suis pas forcément dans la justification des choix. Les choix sont arrivés. Ils se sont imposés d’une manière ou d’une autre parce que je les ai aimés. Ils restent. Je me rappelle que plusieurs je suis sorti de la carrière artistique. Je suis sorti par la porte, la fenêtre je suis sorti même par le trou du WC mais je suis toujours revenu par le toit ou en brisant le mur. Il fut aussi un temps où j’avais choisi d’arrêter parce que ça ne me permettait pas de gagner ma vie. Mais disons que j’ai changé à un moment donné ma vision des choses. J’avais envie de continuer à faire de l’art. Et je me suis dit avec quelques amis, faisons d’autres choses. Allons créer une entreprise, allons investir dans quelque chose qui nous rapporterait de l’argent, qui nous apporterait une certaine sérénité et qui nous permettrait de continuer à faire de l’art. Donc au lieu de faire de l’art pour essayer maladroitement de gagner notre vie et de sombrer complètement dans la pauvreté sans jamais pouvoir faire l’art comme on le voudrait, il était question pour nous d’aller gagner notre vie pour venir faire de l’art comme nous aimons, passionnément.
L’auto-emploi des jeunes dans le contexte du développement local en République du Bénin est le thème de votre mémoire de fin d’étude. Paradoxalement, il se retrouve dans vos œuvres. Comment expliquez-vous cela?
Si ce sujet se retrouve dans mes œuvres, c’est parce que je suis profondément touché par notre situation à nous les jeunes. Je fais partie de ceux qui pensent que nous avons un grand potentiel que l’environnement dans lequel nous vivons gâche parfois. Mais je ne suis pas du tout pessimiste. Au contraire, moi je fais partie aussi de ceux qui imaginent que lorsque vous avez beaucoup de facilité, eh bien vous ne donnez aucune chance à votre génie. Moi j’ai évolué avec des difficultés ; cela m’a servi de terreau. Bien entendu il est un peu maladroit de comparer nos difficultés à nous à celles des autres ; nous ne sommes jamais tous au même endroit ni pour ce qui est de la teneur de nos entraves, ni en ce qui concerne notre force, notre préparation, nos ressources intérieures pour les surmonter. Je pense que j’en ai fini par développer une mentalité qui est que tout ce que je ne sais pas faire je peux l’apprendre. J’estime que nous, les jeunes et du moins ceux qui viennent après nous devrions souscrire à cette mentalité-là. Il n’y pas de plafond, de limite possible à la volonté, à la détermination de faire les choses. Donc il n’y pas que la question du développement local, de l’emploi des jeunes dans mes écrits. Je m’intéresse plus globalement au développement humain, à la place de l’humain dans le territoire. Les questions existentielles me touchent et je suis dans la vie. J’existe. Je suis interpellé.
A seize ans, vous avez fait votre première apparition publique sur la planche, en tant que comédien. Quels souvenirs gardez-vous de ce moment ?
Que de beaux souvenirs. Je me suis bien amusé. Les gens ont bien rigolé. Je me suis senti comme dans un monde qui me connaissait depuis très longtemps. C’est tout et j’ai continué. Je me rappelle aussi que le jour où je savais que ma sœur était arrivée et qu’elle était dans le public, j’étais mal à l’aise, j’étais nerveux. Je n’étais pas comme j’étais souvent sur scène. Et Dieu merci j’ai pris conscience de cela. Et ça c’est très important. Prendre conscience. J’estime qu’aucun homme n’a plus d’excuses dès le moment où il a pris conscience de ce qui arrive. C’est ce que je pense et c’est comme que j’avance. Moi je suis content de connaître le problème. Parce que je n’ai de problème que lorsque je ne sais pas le problème que j’ai. Dès lors que j’ai détecté le problème que j’ai, j’essaie de trouver dix solutions. C’est pourquoi je me définis aussi comme un solutionneur.
Vous avez plusieurs écrits à votre actif dont certains ont reçu des prix et pourtant, vous êtes encore tout jeune. Une gloire précoce selon vous.
(Rires). Vous pensez que je suis tout jeune ? Moi j’ai trente-trois ans et à trente-trois ans, vous n’êtes plus tout jeune. Le parcours que j’ai eu est important non pas sur les résultats mais plutôt sur c’est la diversité de choses qui l’a rencontré. Tout ce que j’ai fait sur les quinze, vingt dernières années c’est ça qui est important. Mais ça on ne peut pas les quantifier . Les distinctions pouvaient venir quand j’avais quinze ou vingt ans. Donc à mon avis recevoir des prix à vingt-six ans, vingt-huit ans c’est n’est pas extraordinaire. C’est la société qui a construit cette mentalité que je trouve rétrograde de penser ou de croire que la gloire ne peut être dévolue qu’aux personnes croulantes, qui sont à la fin de leur vie. Parce qu’on estime qu’il faut mille ans pour réaliser des prouesses. Et nous avons le même problème avec la gouvernance dans nos pays. Nos dirigeants africains ont fait croire aux africains qu’il faut mille ans pour réaliser le développement alors qu’il aurait suffi de poser de vraies actions audacieuses pour provoquer l’amélioration qualitative de la qualité de vie. On n’a pas besoin d’avoir soixante ans pour être grand. Mais on est dans des sociétés, où la pensée associe automatiquement la grandeur à l’âge. Les jeunes sont toujours «en route pour devenir». On reconnaîtra leur travail quand ils seront vieux; on leur donnera leur place quand ils n’en seraient plus qu’à raconter leur vaillance, au passé. C’est assez dommage, mais la vérité c’est que parmi les jeunes il y a des hommes et des femmes qui ont non seulement la vaillance dans l’action, mais aussi une grandeur d’esprit inimaginable.
Pour revenir à moi, il ne s’agit pas de gloire précoce ni tardive. Les choses arrivent au moment où elles doivent arriver, c’est ma pensée.
Dans votre quatrième pièce, “Les inamovibles “, pièce avec laquelle vous avez reçu le Prix RFI Théâtre 2018 et le Prix des Lycéens Bernard-Marie Koltès 2021, vous peignez l’histoire de Malick, un Africain de 36 ans qui immigre en Europe et qui échoue. Les Inamovibles, est-ce pour vous l’histoire de l’échec de cette Afrique qui pense que son développement passe forcément par l’Occident et qui peine à décoller par elle-même ?
En réalité, dans Les Inamovibles, ce n’est pas une histoire d’Afrique. Je parle des hommes, des humains. Cette histoire, on peut la transposer à celle des mexicains qui tentent de rentrer aux Etats-Unis. On peut la transposer un peu partout où il y a migration. Savez-vous qu’il y a plein de gens qui quittent le Moyen-Orient pour l’occident ? Il ne s’agit pas d’une question de l’Afrique, de l’échec de l’Afrique qui pense que son développement ne peut venir que de l’occident. Il y a quand même un paramètre important quand vous utilisez le mot développement. Et je pense aussi comme Felwine Sarr, Achille Mbembe et d’autres que l’Afrique devrait redéfinir les paradigmes de son propre développement et arrêter d’imaginer son développement à partir des modèles du reste du monde. C’est ça qui fait qu’on nous dit que nous ne sommes pas au pas du monde. Non. Nous avons un modèle de développement, qui demande à être précisé et ça non plus n’est pas infaisable. Quand vous retournez dans l’histoire de l’Afrique, l’Afrique avait son modèle d’administration, de gestion de la société. On a besoin de s’entendre un peu à ce que nous appelons le développement, comment est-ce qu’il s’envisage à notre niveau etc. Dans Les Inamovibles, je parle de l’humain, de sa quête de déplacement, de la nécessité qu’il aille voir d’autres bouts du monde. Qu’il soit libre de bouger. Je parle aussi de l’attente de revoir un être cher.
Vous avez ”un style d’écriture musclé et taillé”. On retrouve dans certains de vos textes des barres et des slashs. Points de guillemets ou parenthèses. Est-ce pour casser les codes ou pour exprimer un besoin de liberté, de sortir des rangs et d’écrire sans filtre ?
Il ne s’agit surtout pas d’un désir de casser les codes. Je ne fonctionne pas comme cela. Je refuse la démonstration. Par contre j’aime la performance, la recherche. Mais pour ce qui est de la ponctuation, il ne s’agissait pas de casser quelque code conventionnel. C’est que j’étais arrivé à un moment où je ne trouvais pas la ponctuation qui pouvait exprimer ce que je voulais. Il arrivait par exemple des moments où j’avais envie que la parole soit prise automatiquement avant la fin du propos qui précède. Il fallait donc le notifier à chaque dans les didascalies. Je trouvais ça, pas interessant. J’ai juste installé un code pour dire dès que vous voyez un slash, ça veut dire que celui qui vient coupe la parole à celui qui précède. Aussi, je fais un travail de réflexion sur la parole par les pensées. Comment est-ce qu’on peut transcrire les pensées ? Comment est-ce qu’on peut les écrire? Vous savez quand vous écrivez, vous écrivez plus lentement que vous ne pensez. Le rythme d’écriture est beaucoup plus lent et il vous permet de rationaliser certaines pensées. Mais si vous deviez transcrire la pensée in extenso dans son rythme a lui, comment est-ce vous la transcririez ? Puisqu’au moment où je suis en train de penser à une chose, je peux penser à plusieurs choses en deux secondes. Comment je transcris ça ? Est-ce que ces pensées se chevauchent ? Oui elles se chevauchent parfois. Mais comment j’écris la façon dont elles se chevauchent sur le papier ? Cela nous amène à poser des questions sur la ponctuation. Comment faire pour que le texte soit écrit exactement de la façon dont les pensées arrivent dans nos têtes. Là, on retourne dans la ponctuation.
Si je vous disais ” Il pleut des humains sur nos pavés”* que me répondrez-vous ?
Je vous dirais que contre les systèmes qui vous mettent à genou, ce n’est pas la pierre qu’il faut lancer mais la pensée: LA PENSÉE
* La dernière representation de l’auteur à l’Institut Français de Lomé